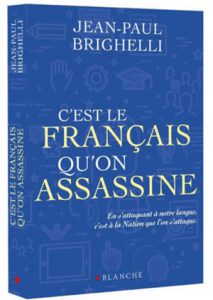Jean-Paul Brighelli manie le verbe comme d’autres le fleuret. D’Artagnan de la langue, il croise, pare, feinte et botte avec une aisance qui fascine autant l’auditeur que le lecteur. Chaque page se dévore, dans un style où la fluidité ne s’embarrasse ni d’emphase ni d’euphémismes, où les choses sont dites telles qu’elles sont : ce récit impudique d’une réalité décrite dans toute sa nudité questionne, bouscule et fait souvent passer l’auteur pour un provocateur.
La lecture de l’ouvrage s’achève avec la même frustration pour le lecteur que celle des auditeurs des tribunes qu’il anime : on en veut encore, on a mille questions, on ne veut pas en rester là. Certains l’admirent, d’autres le défient. On l’adore, on le déteste, il ne laisse jamais indifférent. C’est là tout son art; quelle que soit la question posée, même la plus rébarbative, il nous conte une histoire à la manière d’un Kusturica : l’un manie la caméra et met en images les absurdités d’un monde hétéroclite, l’autre manie la langue et met en mots les incongruités d’un système ravagé. Sa tchatche littéraire vagabonde avec la même liberté et la même richesse que celle du cinéaste, tout aussi politiquement incorrect – puisque l’incorrection désigne aujourd’hui l’impertinence à s’exprimer hors des sentiers battus d’une pensée aussi conformiste que totalitaire.
Ainsi, sur un ton assumé de polémique et de provocation, Brighelli n’hésite pas à dénoncer les grands inutiles de la Nation dont l’incompétence frise le génie lorsqu’ils entament les manœuvres d’abrutissement de nos élèves, il dresse des constats irréfutables que le lecteur est forcé de reconnaître, qu’il soit ou non professionnel d’éducation : la misère lexicale, la pauvreté culturelle, l’indigence orthographique, l’incapacité linguistique… au fond, la déficience intellectuelle.
À l’opposé de ce constat, sa pensée se nourrit de références empruntées chez des auteurs de tous les siècles, son propos foisonne de citations et d’exemples en tout genre, qui emportent à la façon des orateurs antiques dont il maîtrise l’art et la manière : inventio, dispositio, elocutio. Cette érudition pourrait le faire passer pour un cuistre magister s’il n’étayait également sa démonstration d’anecdotes aussi affligeantes que réalistes et de constats aberrants mais authentiques glanés dans le quotidien de nos classes, démontrant au passage une expérience professionnelle qui fait autorité.
L’auteur revient sur la question des horaires consacrés à l’enseignement du français et réduits comme peau de chagrin. Il écorche les experts auto-proclamés qui, dans le sillage de ceux qui ont institué que la parole de l’élève avait désormais autant de poids que celle du maître, ont fait de «l’expression» le but ultime de l’apprentissage. La parole est à l’élève, quand bien même il n’aurait rien à dire. Et que peut-il avoir à dire quand on s’est efforcé de réduire sa culture, ses compétences et sa connaissance de la langue à un socle minimal ? C’est d’ailleurs ce que traduit le brouhaha si communément audible dans nos classes, pourtant encouragé par de glorieux IPR au «ventre usé par la marche». Et Brighelli les cite – et tient leur nom sous le coude : « peu importe s’il y a du bruit dans vos classes, cela signifie qu’il y a de la vie […] La première forme d’oral, c’est le « ,papotis » (sic !). Il est très important de papoter».
Au-delà de cette décadence linguistique, il rappelle aussi les enjeux et conséquences pour la Nation tout entière, déjà pressentis lors du protocole de Lisbonne. « Parce que les mots pour le dire servent aussi à protester, l’ignorance est devenue une nécessité». Brighelli nous rappelle fort justement que la nature a horreur du vide : cet espace de cerveau rendu disponible est alors susceptible d’être pris d’assaut par toutes sortes de contenus, autant par l’endoctrinement publicitaire que par celui des complotistes et fanatiques religieux.
À l’austérité si caractéristique de l’effort que réclame un apprentissage traditionnel dans la concentration, nos réformateurs opposent l’expression spontanée et le vivre ensemble. Pour eux, tout est bon pour tuer l’ennui d’une leçon, tout est prétexte à simplification – et peu importe la dénaturation : l’exemple le plus grotesque est celui de la série Club des Cinq réécrite dans une bouillie lexicale, syntaxique et idéologique jugée plus digeste pour des élèves que l’on a cessé de nourrir des richesses prodigieuses de la langue et de la culture françaises. Le tout-numérique tellement plus ludique finira d’ailleurs d’achever l’éradication d’un livre – tel que celui-ci – que l’on ne trouve plus qu’entre les mains des «inhtellos», injure nouvelle de ceux qui cultivent l’inculture.