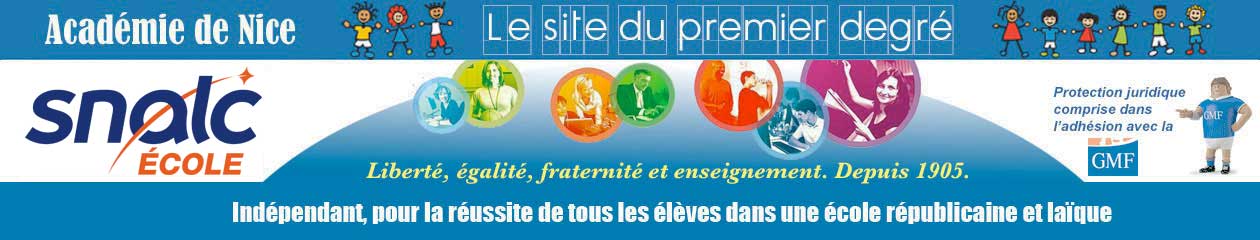En manque d’inspiration et dans une volonté manifeste de malmener les enseignants, la Cour des comptes a une nouvelle fois produit le même rapport sur l’Éducation nationale et le « coût » des absences des enseignants. Blablabla annualisation… blablabla bivalence… blablabla davantage de pouvoir au chef d’établissement. Le SNALC vous fait grâce de l’ensemble : il est pitoyable.
Le SNALC constate que la Cour n’a d’autre volonté que de rendre un métier en crise encore moins attractif. La mise en œuvre de ses préconisations permettrait d’aggraver la crise, et donc le problème des remplacements, le tout en dégradant la qualité de l’enseignement (mais ça, visiblement, la Cour s’en tape). On note d’ailleurs que les mesures prises ces dernières années par le ministère et qui vont dans le sens de la Cour (possibilité d’imposer une deuxième heure supplémentaire, temps de formation le soir ou pendant les vacances scolaires, heures supplémentaires pour que des assistants d’éducation « remplacent » des professeurs absents en passant aux élèves une vidéo du CNED tirée au sort sur la plateforme) ont à chaque fois été dénoncées par les syndicats représentatifs, dont le SNALC. Rien de tel que d’imposer à un métier tout ce que ce métier rejette pour améliorer les conditions de travail et la communication.
Lire la suite