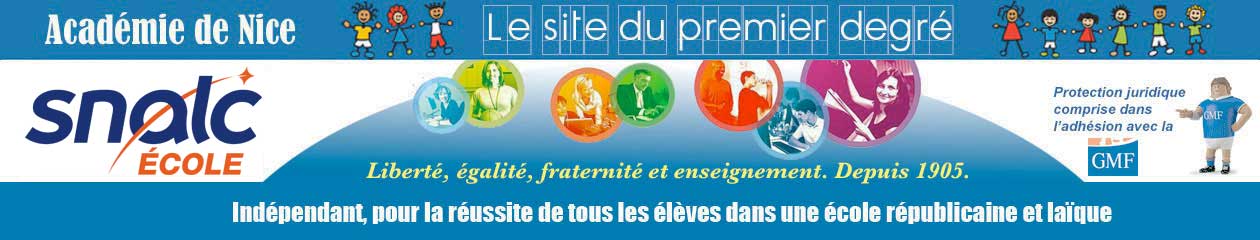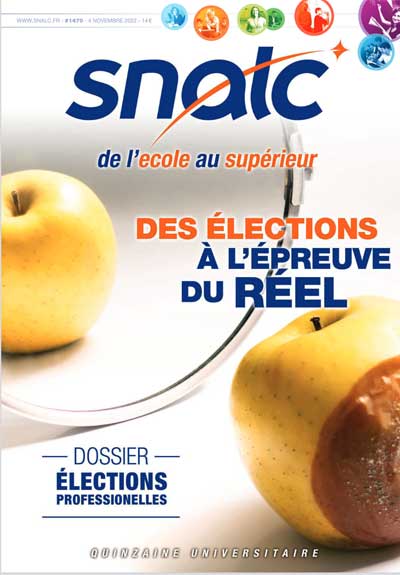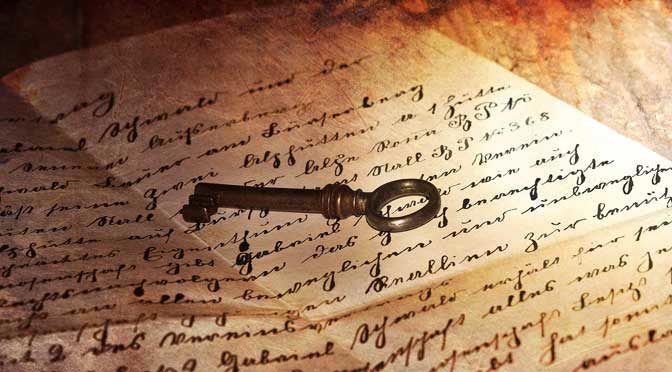Pénibilité : le bruit, source de fatigue, voire de souffrance
Le SNALC pointe en 2022 une des causes de souffrance au travail qui impacte l’ensemble des personnels et des élèves. À savoir : le bruit.
Le bruit, cause de fatigue pour les professeurs des écoles
Le bruit fait partie intégrante du quotidien des enseignants. Certains vont minimiser : « C’est dérangeant mais à la fin on s’y habitue » ; d’autres font un triste état des lieux « Le soir, j’ai fréquemment mal à la tête. Je suis épuisé. » Au-delà du constat, c’est une réalité qui ne trouve pas écho auprès de notre hiérarchie. Aucune prise en compte et encore moins de prise en charge de ce phénomène n’est faite.
Les niveaux préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Union européenne sont éclairants, à savoir, pour les écoles, un niveau de bruit de fond ne dépassant pas les 35 décibels au sein de la classe. Malheureusement, dans les faits, il n’en est rien et on en est très loin.
Quelles sont les sources de bruit à l’école ?
Les niveaux sonores sont très élevés et les causes multiples. Une étude datant de 2009 a montré que les élèves et les enseignants sont soumis, au cours de leur journée, à une exposition supérieure à 80 décibels. Il est alors difficile d’imaginer comment les professeurs des écoles peuvent enseigner et comment les élèves peuvent apprendre.
Ceci est dû à la faible isolation phonique des parois et des fenêtres. Le bâti date et n’est pas plus isolé thermiquement que phoniquement, ne nous le cachons pas. Aussi, après six heures de cours dans le brouhaha, en maternelle notamment (ah, joies de la petite section), on finit la journée dans un triste état. Sans oublier, quand il y a des récréations successives, le bruit de la cour que le simple vitrage des années 60 ne parvient pas à atténuer. La cour de récréation est en moyenne à 88 décibels et avoisine parfois les 100. A ceci s’ajoute la nécessité d’ouvrir pour aérer les virus ou éviter de passer la barre des 46 degrés Celsius au mois de juin dans des salles de classe non-climatisées, par goût affiché et assumé du vintage.
Lire la suiteJ’y vais ou j’y vais pas ?
Dans les échanges, parfois formels, parfois informels, avec notre hiérarchie, on peut se trouver face à des demandes pour lesquelles on ne sait pas trop quoi faire ou auxquelles on ne sait pas trop quoi répondre. Qu’est-ce qui s’impose à nous et qu’est-ce qui ne s’impose pas ?
Faisons simple. On a obligation de répondre présent lorsque l’on reçoit une convocation. Elle doit être écrite, nominative, préciser quoi, où, pourquoi, dans quelles conditions. On ne peut y déroger. A l’inverse, une invitation n’a pas de valeur obligatoire et l’on n’est pas obligé d’y répondre.
Un ordre de mission est un peu différent puisque c’est le document par lequel l’administration ou l’établissement public ordonne ou autorise préalablement le déplacement temporaire du professeur concerné. Il précise les dates, le lieu de l’exécution et le type de la mission, de la formation ou du stage et le défraiement éventuel, en tenant compte des temps de transport nécessaires pour l’accomplissement de la mission. Il peut être renouvelé.
Dans les cas justifiés par les fonctions exercées, un ordre de mission permanent peut être délivré pour une durée déterminée. L’ordre de mission a un caractère individuel et ne peut excéder une durée de douze mois. Il est signé par l’autorité hiérarchique compétente.
Bien évidemment lorsque l’on est en arrêt de travail par exemple, on ne travaille pas donc on ne répond pas à un ordre de mission ou à une convocation.
Une convocation, un ordre de mission ou une invitation se font par écrit. Par courrier ou par mail, mais par écrit, pas à l’oral. Il faut que vous sachiez de quoi il retourne et que vous ayez une trace pour être couvert en cas d’accident lors d’un déplacement.
Lire la suite